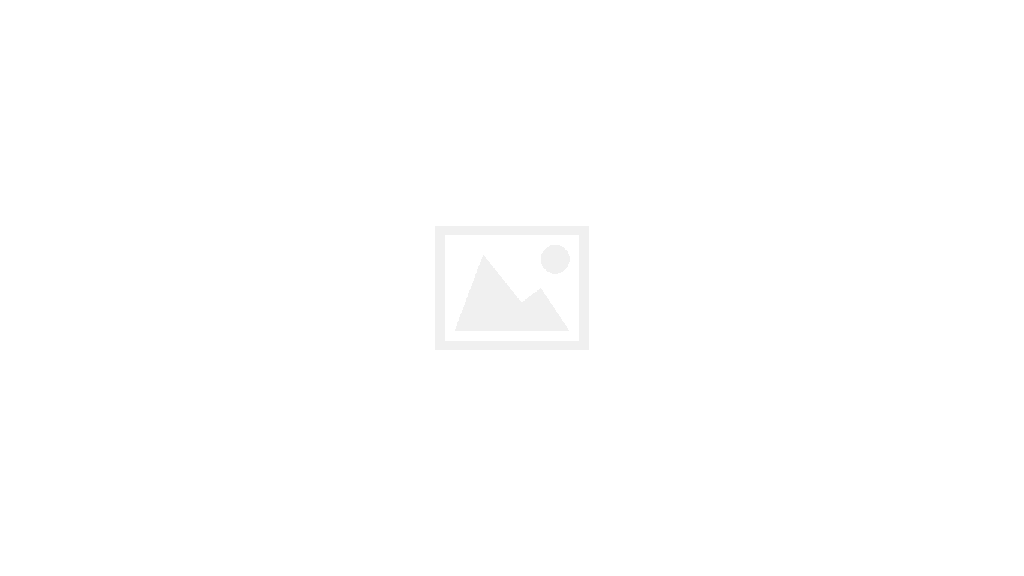De La Sortie de l’usine (1895) des Frère Lumière aux images cosmiques du Tree Of Life (2011) de Terrence Mallick, un long siècle de cinéma a effectué le plus grand écart possible. Parti de son voisinage de naissance, la fabrique et la ville, le cinéma a conquis le cosmos par l’image (ce qui est montré) et par la représentation (ce qui donné à penser).
Le cinématographe, rat des villes
Né dans la ville et l’industrie, le cinématographe a d’abord filmé son environnement immédiat : l’usine, le peuple laborieux, les rues, les bâtiments, les machines. Désireux de rentabiliser leur invention, les Frères Lumière envoyèrent des techniciens aux quatre coins du monde pour capter des vues remarquables et les projeter aux publics. Ces premiers paysages, ni fictions, ni vraiment documentaires, sont essentiellement urbains et touristiques. Les films étaient comme des cartes postales animées qui soulignaient ce qui frappait la sensibilité occidentale de ce siècle finissant : monuments, scènes de la vie, machines. En un mot : la modernité. Peu mobiles, lourds, volumineux et fragiles, les cinématographes des Lumière n’invitaient pas à l’exploration d’espaces non aménagés. C’est donc ce qui était proche de l’homme qui fut capté.
La propagation de la technique, sa réputation et finalement son succès, encouragèrent des réalisateurs à s’en emparer pour l’améliorer et diversifier les contenus de ce phénomène de foire[1]. La fiction apparut à travers des saynètes filmées comme au théâtre. L’œil de la caméra restait le même que celui du spectateur, une sorte d’œilleton ouvert sur un monde. Spectacle de foire, le 7ème art balbutiant était presque exclusivement un « cinéma d’attraction[2] », un pur spectacle sensationnel à l’instar des trains fantômes. Il émouvait d’abord par le mystère intrinsèque de la performance de la projection d’images animées, puis par leur contenu, vecteur d’étonnement ou de vertige. Parmi les pionniers, Méliès est certainement celui qui pousse le plus loin ce principe. Prestidigitateur de métier, il exploite à fond le cinématographe pour provoquer les exclamations d’un public en quête de frissons. La narration du montage se résume à lier les scènes les unes aux autres, dans un semblant d’histoire.
Pour le cinéma d’attraction, la nature avait peu d’atout. Les moyens technologiques rudimentaires ne permettaient pas de reproduire sur écran le grandiose des curiosités naturelles. Il fallait filmer ce qui était à échelle humaine. Décors passifs des quelques scènes tournées en extérieurs ou panneaux peints en arrière-plan des premiers studios, les paysages ont une place marginale. La difficulté de rendre compte des profondeurs et des perspectives incitent d’ailleurs à déformer les éléments pour les rendre spectaculaires. Il en va ainsi de la lune du Voyage dans la lune de Méliès ou des décors d’opérette de la plupart de ses œuvres. Ce ne sont pas des cartes postales mais des visions fantasmagoriques d’une nature stéréotypée, indice du lieu de l’action lorsqu’il s’agit de mettre en scène l’étranger ou l’étrange.
Escapades au grand air
Bien que largement tourné en extérieurs, le premier long métrage du cinéma, The Story of the Kelly Gang[3], donne peu de fonction à l’environnement, sinon celui d’identifier dans quel cadre se déroule l’action : la forêt, la plaine, un intérieur… Ce décor naturel ne présente aucune attraction par lui-même, l’intérêt des scènes se focalise sur l’activité des personnages, perpétuellement à l’image. Premier succès de l’histoire du cinéma, Naissance d’une nation de Griffith est pareillement composé de scènes d’intérieurs et d’extérieurs. Griffith choisira de reconstituer les lieux extérieurs avec grand soin, dans un souci d’authenticité des batailles historiques qu’il met en scène. Toutefois, il n’y cherche pas la nature à proprement parler, mais le rapport authentique que ces paysages entretiennent avec l’histoire humaine.
L’attractivité cinématographique de la nature émerge avec les scènes de chasse. Le réalisateur Alfred Machin se spécialise à ses débuts dans une approche animalière lors de tournages éloigné du confort des studios, à l’occasion d’expéditions en Afrique : La chasse à l’hippopotame sur le Nil bleu, La chasse à la panthère,… L’exotisme de l’animal, de son cadre de vie et sa dangerosité constituent les deux moteurs d’un spectacle naturaliste qui correspond certainement à l’esprit d’une élite qui conçoit volontiers la découverte de la nature par la pratique de la chasse.
De 1895 à la Première Guerre mondiale, la stratégie des studios de production, en tête desquels se positionnent les français Pathé et Gaumont, consiste à produire annuellement des centaines de courts-métrages très majoritairement tournés dans des « théâtres » aménagés pour le cinéma (les premiers studios). Mais grâce à l’incroyable succès commercial[4] de Naissance d’une Nation, le long-métrage devient l’étalon des succès à venir. L’investissement financier et l’amélioration de la maniabilité du matériel, permettent aux réalisateurs de sortir en partie des plateaux et de poursuivre une ambition esthétique à l’extérieur.
Jacques Feyder ouvre sans doute la voie en 1921 avec L’Atlantide. Adaptation d’un roman, le film se déroule en bonne partie dans le désert du Sahara et nécessite plusieurs mois de tournage en extérieurs. Les paysages désertiques jouent un rôle : ils accentuent le drame et surtout, soulignent l’exotisme d’une aventure teintée de fantastique. Pour la première fois sans doute, les paysages y sont utilisés pour ce qu’ils sont. Le film cherche à mettre en images « L’attrait mystérieux des grandes solitudes », comme le signal un panneau textuel de cette œuvre muette.
En 1923, Abel Gance réalise La Roue, une fresque immense, dont une des versions dure 8 heures. L’histoire démarre à Paris, dans un cadre industriel et mécanique, pour s’achever dans les Alpes. L’action commence dans un univers d’acier et de vapeur, indice de la condition ouvrière et de l’injustice des rapports de classe qui sont l’axe du drame, pour continuer dans les paysages enneigés des cimes françaises, dont la pureté est significative du rapport intime qui se nouent entre deux amants séparés. Ce passage du contexte urbain à un environnement naturel, spectaculaire, est peut-être une des premières exploitations métaphoriques d’un paysage. L’Atlantide et La Roue feront date pour les prouesses de la technique et de la production dans la mesure où les tournages durent s’organiser dans des lieux naturels peu accueillants, spécifiquement retenus pour les besoins de la fiction, et engendrèrent des coûts importants. Loin du confort des studios ou des villes, la voie est désormais ouverte pour que le cinéma s’aventure dans des espaces qui ne sont pas fait sur mesure afin d’en ramener des images qui répondent aux attentes des spectateurs et à l’appétit des financiers.
Des images du réel aux images irréelles
La conquête de la nature par le cinéma suivra à la fois l’audace des réalisateurs et l’évolution de la technique. L’apparition des images aériennes à la faveur de 14-18, permettra d’apporter un point de vue proprement spectaculaire sur les paysages. Quant aux images sous-marines, apparues dès 1916[5] et popularisées par les documentaires à succès des pionniers Hans Hass (dès 1942) et Jean-Jacques Cousteau, elles inspireront aussi de nouveaux cadres pour les fictions à venir.
Dans les années 1930, l’arrivée progressive de la couleur issue de prises réelles, ouvre à son tour de nouveaux horizons esthétiques. Consacré auprès du public à l’occasion de Blanche Neige et les Sept nains (1937), le Technicolor contribue largement au succès massif d’Autant en emporte le vent (1939). L’introduction de cette technique permet à l’alliance de la composition d’image et des splendeurs naturelles de passer la vitesse supérieure. Les silhouettes de Scarlett O’hara et de Rhett Butler découpées sur le ciel embrasé d’un soleil couchant resteront encore longtemps dans les mémoires cinéphiles.
Mais c’est l’élargissement des formats de projection associé à la couleur qui donneront aux paysages du cinéma la pleine puissance de leur esthétique[6]. Lawrence d’Arabie, tourné en 70mm en 1962[7], accomplira ce que L’Atlantide cherchait déjà : faire du désert un personnage à part entière pour singulariser le drame. Les avancées technologiques permettent désormais de satisfaire la sensibilité du spectateur face aux merveilles naturelles[8], mieux que ne le ferait l’œil humain.
Rapidement associés au genre du western[9], les paysages authentiques et sauvages contribuent désormais au spectacle cinématographique. L’exotisme et la grandeur des lieux seront largement exploités par les superproductions. Mais bien qu’il ait découvert ses propres capacités narratives, le cinéma reste toujours attaché à sa fonction première : être une attraction. Les réalisateurs ne cesseront de chercher l’époustouflant. Dédaignée dans les premiers temps, la nature peut dorénavant être filmée sans limite. Tout ce que l’homme pourrait voir, la caméra peut le capter.
La quête du spectacle pousse les films à inventer un nouveau regard sur l’environnement en imaginant des décors qui n’existent pas. Avec son extraordinaire paysage lunaire, Le Voyage vers la lune de Méliès préfigurait déjà un des ressorts de la science-fiction et du space opera. Des natures extraterrestres factices, à la fois grandioses et hostiles, dynamiseront efficacement bon nombre de productions. Inspirées par l’imagerie spatiale naissante et avec l’aide de techniciens de la NASA, les vues spatiales constitueront une facette de l’évènement de 2001 l’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, 1968). Une décennie plus tard, les paysages et les environnements fictifs des planètes de Star Wars constituent un des traits de la saga[10].
Aux côtés d’une nature imaginaire, le cinéma, largement aidé par les expérimentations du documentaire et les innovations techniques, continue à explorer l’attrait esthétique de l’environnement en présentant au public ce qu’il ne peut pas voir. Ni fiction, ni documentaire, le poème visuel Koyaanisqatsi (1983) fera forte impression pour le travail sur les images, naturelles ou urbaines, qui prennent un sens différent en fonction des perspectives, des accélérations, des comparaisons d’échelle, etc. Le film animalier Microcosmos offre quant à lui un regard presque intime avec le monde des insectes, grâce des caméras macro. Depuis les années 1990, et le succès à la fois public et technique de Jurassik Park, les images de synthèse ouvrent la voie à un imaginaire de la nature qui culmine en 2009 avec Avatar. En exploitant pleinement la puissance de l’imagerie numérique 3D, largement explorée par les jeux vidéos, James Cameron livre un long-métrage où artificiel et réel se démêlent difficilement. Le succès du film tiendra pour beaucoup au spectacle extraordinaire de la planète Pandora, alter ego édénique de la Terre, dont la préservation est l’enjeu du drame. Montagnes flottantes, faune excentrique, flore exubérante,… Pandora est un fantasme naturaliste qui ferait pâlir d’envie les plus beaux paysages terrestres[11].
La technologie de l’image a repoussé les limites de la représentation de la nature au-delà de la nature elle-même. Si ces techniques permettent aujourd’hui de tout représenter, surtout ce qui n’existe pas, elles ont ouvert la voie à la mise en image d’un regard impossible. The Tree of Life de Terence Malick, poème symphonique aux accents mystiques sur la vie, propose des vues de la naissance de l’univers et de la vie terrestre, notamment créées avec l’aide de la NASA, et qui sont des « perspectives d’artiste » de modèles astronomiques[12]. Offrant de la sorte un regard omniscient qui ne pourrait être que celui d’un Créateur, The Tree of Life, et avec lui le cinéma, repousse les frontières de l’image à celles de l’imaginaire humain.
La Nouvelle Zélande devenue Terre du Milieu
Les adaptations de Tolkien réalisées par Peter Jackson illustrent spectaculairement le rapport particulier qu’entretient le cinéma avec les décors naturels. La Terre du Milieu est un monde imaginaire créé par l’écrivain britannique où se déroulent les aventures du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ce monde est constitué d’une géographie fouillée, parsemée de nombreux lieux clé des aventures dont les textes détaillent les ambiances et les caractéristiques. La dimension itinérante de ces récits de Tolkien amène le lecteur à se plonger dans une géographie et à lui donner mentalement « vie ». Le succès planétaire des romans s’est accompagné d’une vaste appropriation populaire de l’univers à travers les adaptations ludiques, notamment à travers le jeu de rôles, qui ont généré de nombreuses illustrations graphiques. Au moment de réaliser la trilogie du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson savait qu’il devait porter à l’écran les paysages que l’imagination de millions de fans avait déjà visités.
Néo-Zélandais lui-même, Jackson choisit d’installer ses plateaux de tournage sur cet archipel réputé pour ses merveilles naturelles. Les majestueux espaces sauvages, montagneux et forestiers – ni trop exotiques au regard occidental, ni trop familiers à l’horizon touristique – allaient devenir la matière première pour établir l’imagerie de la Terre du Milieu. Le choix fut judicieux et s’il est quelque chose que ces films ont su durablement inscrire dans l’expérience des spectateurs, ce sont précisément les scènes extérieures et les panoramiques aériens qui donnaient une ampleur inattendue et « réelle » aux paysages tolkieniens. Dix ans après la trilogie, Jackson remet le couvert avec Le Hobbit et réinvestit sa terre natale. La présence des extérieurs prend encore plus d’ampleur et le travail sur les paysages profite pleinement des manipulations numériques. Grâce aux effets de lumière, de couleurs et à l’ajout d’éléments fantastiques dans des paysages déjà généreux, la nature néo-zélandaise est à la fois sublimée et détournée pour donner encore plus de consistance à l’univers enchanteur de Tolkien.
Le triomphe mondial des adaptations illustre la puissance de représentation du cinéma. L’imaginaire de la Terre du Milieu est désormais colonisé par les images des films et il sera sans doute difficile d’en échapper. Quant à la Nouvelle Zélande, ses paysages millénaires ont acquis une nouvelle réputation : il n’est plus un guide ou une promotion touristique qui ne fasse écho à l’impression laissée par les films. Désormais l’archipel océanien est le lieu où on peut visiter la Terre du Milieu. Par un curieux effet de retour, les paysages terrestres profitent de la réputation des fantasmes qu’ils ont contribué à créer.
Les paradoxes des paysages cinématographiques
Né de l’industrie et de la culture occidentale, le cinéma a colonisé l’univers en suivant un parcours à deux voies. C’est à la fois une conquête technologique – les innovations ont permis la mise en images de l’environnement – et une conquête intellectuelle car, de l’usine au Big Bang, le cinéma a accompagné l’évolution de la sensibilité moderne face à la nature. D’abord fasciné par les machines et le patrimoine, le spectateur est dorénavant confronté à des spectacles globaux et cosmiques. L’histoire de ces images n’est donc pas sans lien avec celle de la conception que les contemporains ont de leur place dans l’univers. Si les émotions ressenties à la vision des films qui valorisent la nature participent ou révèlent l’empathie des spectateurs pour l’environnement, on peut relever quelques paradoxes propres à la dimension médiatique de ces spectacles.
D’abord, la mise en images de l’environnement est un succès technologique intimement lié à une modernité industrielle dont on ne cesse de souligner les menaces qu’elle représente pour la nature. La sensibilisation du grand public à l’écosystème est d’une certaine manière tributaire de cette industrialisation, dont un des symptômes est l’émergence des médias de masse. Rien n’est peut-être plus emblématique du triomphe de l’industrie cinématographique dans ce qu’elle a, précisément, d’industriel et de factice qu’Avatar, blockbuster hyper technologique aux thèmes écologique et anti-industriel. Lorsqu’il montre la nature, le cinéma ne se contente plus de la filmer, il la recrée et la modélise pour ses besoins. Elle devient une marchandise produite en fabrique.
Ensuite, l’évolution du point de vue cinématographique sur la nature. Si la plupart des œuvres propagent explicitement un discours écologique qui dénonce la suffisance de la société industrielle face à l’environnement, ces mêmes films adoptent régulièrement une perspective explicative totale dont on oublierait presque qu’il s’agit aussi d’un regard humain. En d’autres termes, le cinéma englobe la nature sous un regard holistique qui n’a plus rien de naturel. De la traque d’un animal sauvage lors d’une partie de chasse à la mise en image de la naissance de l’univers, l’ambition cosmogonique du cinéma ne cesse de progresser. De la sorte, il adopte la posture de la modernité industrielle et scientifique face à la nature : la suprématie de l’esprit sur la matière.
Enfin, l’esthétisation peut aussi interpeller. Une grande partie de l’évolution de la technique s’est faite pour rendre compte de l’environnement tel qu’on le perçoit à l’œil nu. C’est en gros l’histoire du cinéma jusqu’à la couleur qui a abouti à une représentation de l’environnement « fidèle à l’œil ». Le cinéma de l’attraction n’a eut de cesse d’améliorer ces images. Si choisir un point de vue et de sélectionner un plan plutôt qu’un autre est déjà une manière d’esthétiser, la tendance est à la sublimation de la nature, au point de la réinventer, pour la rendre plus attractive qu’elle ne le serait réellement aux yeux d’un observateur humain. La quête de la sensation naturaliste qui magnifie l’univers présente alors le paradoxe de surclasser l’environnement réel. La sensibilité environnementale serait prise au piège des grandeurs du cinéma.
Industrialisation des images, supériorité du point de vue et esthétique irréelle du réel, sont les effets collatéraux des ambitions du cinéma. Les lui reprocher serait nier le plaisir et la fascination qu’il exerce sur les spectateurs et lui attribuer des responsabilités qu’il n’a pas forcément. Le traitement factice qu’il fait de l’environnement correspond à sa nature de spectacle et est mis au service de l’imaginaire généreux des auteurs. Le cinéma reste cependant significatif des manières ambigües par lesquelles la société dont il est issu pense, problématise et exploite le monde qui l’environne.
Daniel Bonvoisin
(Cette analyse a été initialement publiée sur www.media-animation.be en 2013)
Cinéma et nature
Le cinéma est l’enfant de la Révolution industrielle. Flux d’images mis au service de l’imaginaire, il s’est d’abord ancré dans une culture occidentale largement articulée autour du progrès scientifique, technique et économique. Tout au long du 20e siècle et jusqu’à nos jours, son histoire témoigne de celle des mentalités comme l’illustre les rapports qu’elle entretient avec l’environnement. D’abord absent ou factice, l’environnement s’est lentement imposé dans les images selon qu’évoluaient les manières de le filmer et de le concevoir, laissant entrevoir une certaine idée de la nature et des rapports que les hommes entretiennent avec elle. Représenter la nature dans le cinéma de fiction, c’est prendre plusieurs positions à son sujet. Le défi est d’abord technique : il s’agit d’élaborer ses images. Que veut-on montrer d’elle et comment s’y prendre (Le cinéma à la conquête des paysages de la nature) ? Il est également conceptuel car les images doivent avoir un sens dans le récit du film. Dès lors, quelle est l’utilité de la nature dans le 7ème art ? Quelle est sa fonction dramatique (Les fonctions narratives de la nature au cinéma) ? Il est enfin politique : qu’est-ce que le film dit d’elle lorsqu’elle devient un sujet à part entière (L’écologie au cinéma) ?
Quelques jalons de la conquête cinématographique de la nature
1895 : La Sortie de l’usine Lumière à Lyon de Louis Lumière, France : conventionnellement considéré comme le premier film de l’histoire.
1902 : Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, France : dont on peut notamment retenir l’excentricité des paysages Lunaires.
1906 : The Story of the Kelly Gang de Charles Tait, Australie : premier long-métrage (c’est-à-dire d’une durée supérieure à 60 minutes) dont beaucoup de scènes furent tournées en extérieurs.
1908 : La chasse à l’hippopotame sur le Nil bleu d’Alfred Machin, France : premier film animalier d’Alfred Machin.
1915 : The Birth of a Nation de D.W. Griffith, USA : premier grand succès de l’histoire du cinéma dont de nombreuses scènes ont été tournées dans des décors naturels conformes à la dimension de reconstitution historique de la Guerre de Sécession.
1916 : 20,000 Leagues Under the Sea de Stuart Paton, USA : premières images réelles de fonds marins.
1921 : L’Atlantide de Jacques Feyder, Belgique/France : le désert y est traité pour lui-même à l’occasion d’un tournage « in situ » au Sahara.
1922 : La Roue d’Abel Gance, France : un film fondateur du langage cinématographique, également tourné en décors naturels qui utilise les images des Alpes à des fins narratives.
1939 : Gone with the wind de Victor Fleming, USA : le triomphe planétaire du Technicolor sur fond de soleil couchant.
1953 : Nouveaux Horizons de Marcel Ichac, France : premier documentaire en format scope dont le sujet, la majesté des montagnes, marque peut-être les épousailles définitives entre l’image en mouvement et les merveilles naturelles.
1962 : Lawrence of Arabia de David Lean, GB : le format « scope » au service du désert.
1968 : 2001, a Space Odyssey de Stanley Kubrick, GB/USA : la planète terre est embrassée d’un seul regard à l’occasion du premier spectacle cosmique convaincant du 7ème art.
1977 : Star Wars IV : A New Hope de Georges Lucas, USA : le grand détournement, le désert tunisien devient la surface aride de la planète Tatooine.
1982 : Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio, USA : les techniques cinématographiques permettent d’animer des vues naturelles et de leur insuffler une vie spécifique à l’écran. Ce film doit beaucoup au chef opérateur Ron Fricke, magicien de l’accéléré.
1993 : Jurassic Park de Steven Spielberg, USA : l’imagerie numérique apparue dans les années 1980, et inaugurée avec l’environnement virtuel du film Tron en 1982 de Steven Lisberger, est mise au service de la recréation visuelle d’une nature disparue, celle de la préhistoire et des dinosaures.
1998 : Microcosmos de Claude Nuridsany et Marie Pérennou, France : des caméras macro permettent de saisir ce que l’œil nu ne peut voir, la vie des insectes de nos gazons.
2009 : AVATAR de James Cameron, USA : par l’imagerie numérique et pour une perception en 3D, crée une nature alternative, l’argument majeur du naturalisme dédié au spectacle qui vaut au film de battre tous les records financiers (budget et recettes).
2011 : The Tree of Life de Terrence Malick, USA : hymne cosmique, la Palme d’or 2011 synthétise toutes les techniques cinématographiques pour offrir, outre des images spectaculaires sur l’univers, une perspective globale sur les fondements de l’existence. Vision ultime.
2012 : Bilbo le Hobbit – Un voyage inattendu de Peter Jackson, USA : inaugurée avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, l’association entre les images réelles de la Nouvelle Zélande et les effets numériques les plus pointus produit un décor à la fois naturel et irréel qui donne une consistance inédite à la Terre du Milieu imaginée par J.R.R. Tolkien.
[1] Le cinématographe s’est très rapidement orienté vers une production importante destinée à un public nombreux. Les premières années de la technologie s’accompagnèrent de la naissance de sociétés de production telles celles de Thomas Edison ou les entreprises françaises Pathé et Gaumont dont l’ambition était de conquérir ce nouveau marché.
[2] Pour découvrir ce concept, « Le cinéma des premiers temps : un défi à l’histoire du cinéma ? », Histoire du cinéma. Nouvelles approches, Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 1989, p. 49-63.
[3] The Story of the Kelly Gang de Charles Tait, 1906, Australie.
[4] Plusieurs millions de dollars de recettes pour un coût de 110 000 dollars. Naissance d’une nation de David Wark Griffith, 1915, USA. Jacques Lourcelles, Naissance d’une nation de David Wark Griffith, Ciné club de Caen, http://www.cineclubdecaen.com/realisat/griffith/naissancedunenation.htm
[5] Notons que le film Vingt mille lieues sous les mers (20,000 Leagues Under the Sea), dans sa version américaine muette de 1916, de Stuart Paton, comportait déjà quelques images filmées sous l’eau. Pour le voir en ligne et se rendre compte de l’exploit : http://www.youtube.com/visocinema
[6] La tunique, péplum américain de 1953, était le premier film en cinémascope. La sympathie naturelle de ce format pour les paysages se manifeste immédiatement comme l’illustre l’avant-première française du film qui s’ouvrait par un court documentaire tourné en scope et au titre explicite : Nouveaux horizons. Son réalisateur, Marcel Ichac, avait déjà largement contribué à la présence des paysages dans le cinéma français en étant l’opérateur privilégié des films de montagne.
[7] La Terre des Pharaons, de Howard Hawks en 1955, réalise déjà l’usage spectatoriel du paysage couplé au cinémascope en valorisant les paysages de l’Egypte du Nil, du désert et des pyramides.
[8] Cette sensibilité qu’expriment les réalisateurs se manifeste régulièrement lorsque, fascinés par leur exploration, ils prolongent leurs films de fiction par des documentaires qui valorisent le travail effectué. Ainsi, dans la foulée du Grand Bleu, Luc Besson réalise Atlantis, son homologue James Cameron fait pareil après Titanic en dirigeant Aliens of the Deep sur les formes de vie étranges qu’on rencontre dans les grands fonds. Après Tree Of Life, Terrence Malick devrait réaliser Voyage of Time, un documentaire en IMAX sur la naissance de l’univers.
[9]Jean Mottet, L’Invention de la scène américaine. Cinéma et paysage, Paris, L’Harmattan, 1998
[10] Le désert de Tatooine de Star Wars IV – A New Hope est désormais inscrit dans le patrimoine touristique de la région de Tataouine (Tunisie) où le film a été tourné. La région fictive : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tatooine ; et la région réelle : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tataouine
[11] A en croire quelques médias américains, l’impression édénique d’AVATAR aurait été tellement forte qu’en comparaison de leur cadre de vie, certains spectateurs connaîtraient des épisodes dépressifs post-projection. Malgré les doutes qu’on peut avoir sur l’authenticité de ces troubles lié à la seule vision du film, le simple fait de les imaginer possibles souligne l’efficacité de la représentation du film et le malaise écologique contemporain qu’elle exploite. Jo Piazza , Audiences experience ‘Avatar’ blues, CNN Entertainment, 11 janvier 2010, http://articles.cnn.com/2010-01-11/entertainment/avatar.movie.blues_1_pandora-depressed-posts?_s=PM:SHOWBIZ
[12] L’imagerie spatiale du cinéma doit beaucoup à Douglas Trumbull qui débuta son travail de modélisation artistique pour la NASA. Il a ensuite travaillé pour Kubrick sur 2001, puis pour ses propres films (notamment Silent Running, 1972) et enfin pour Malick à qui il a fourni les images cosmiques de The Tree of Life. Phelim O’Neill, The genius of Douglas Trumbull, The Guardian, 9 juillet 2011, http://www.guardian.co.uk/film/2011/jul/09/douglas-trumbull-special-effects